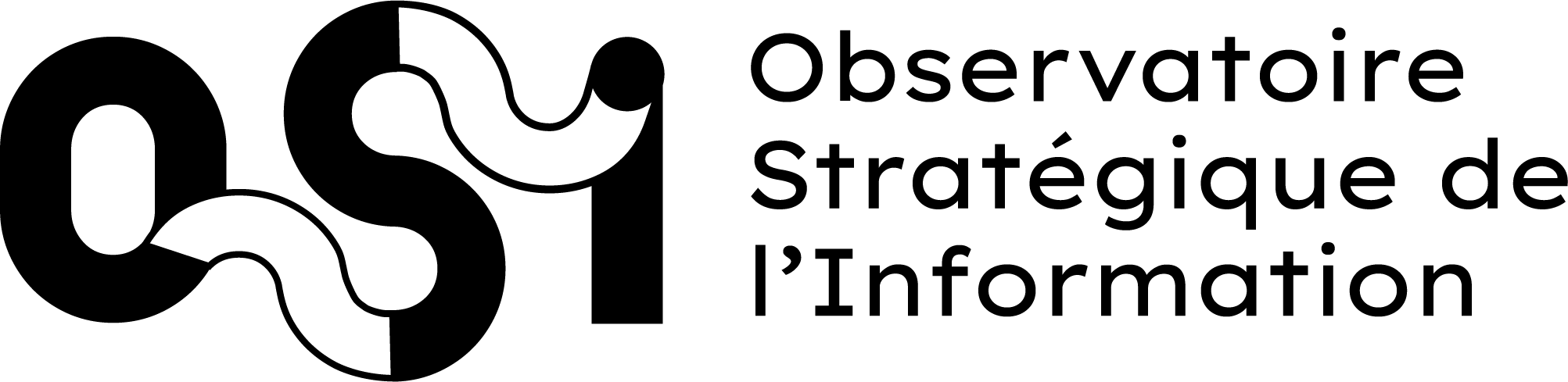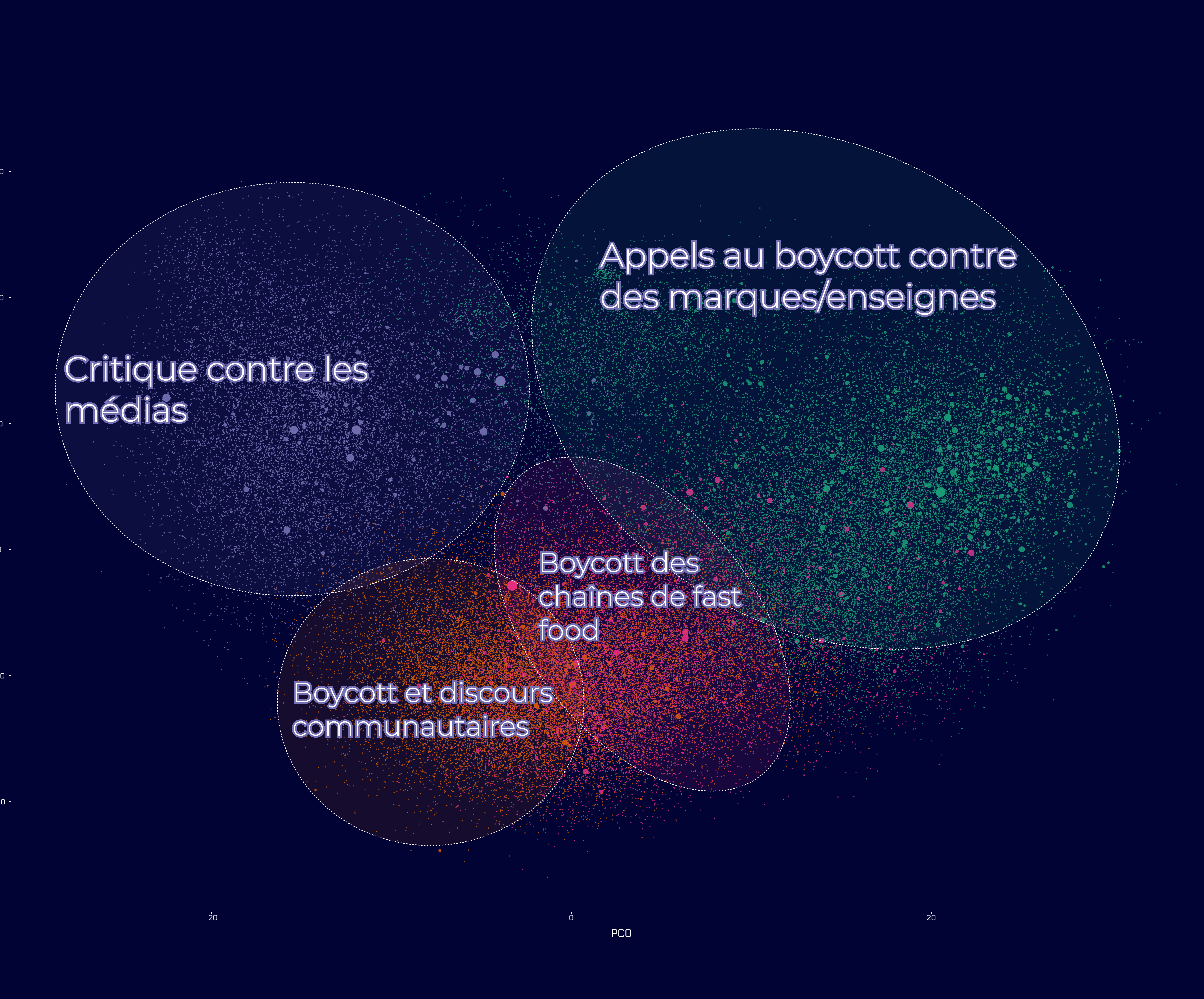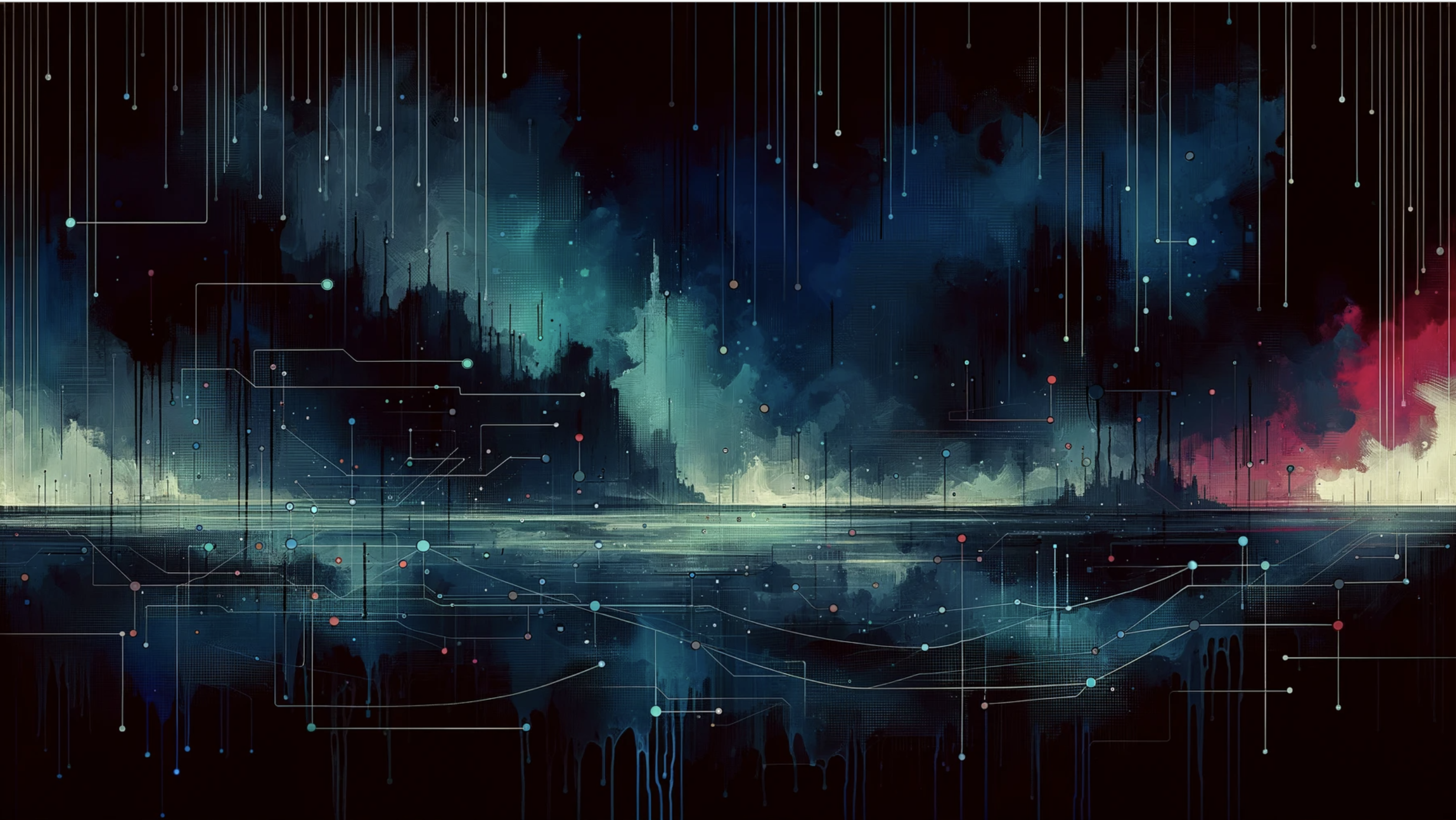La guerre d’Afghanistan : secret, ignorance et mensonge
Auteur(s)
Date
Partager
Résumé
Une machine formatée pour mener une guerre de l’information (au double sens de tout savoir par la technologie et de propager son soft power) peut donc ignorer le principe de réalité non pas malgré mais à mesure de sa puissance même.
Auteur(s)
Date
Partager
Résumé
Une machine formatée pour mener une guerre de l’information (au double sens de tout savoir par la technologie et de propager son soft power) peut donc ignorer le principe de réalité non pas malgré mais à mesure de sa puissance même.
Une guerre, quel investissement, en vies et en argent ? Pour quel résultat ? Et quand sait-on qu’elle est perdue ? C’est la question que soulève un rapport de 2.000 pages, déjà baptisé Afghanistan Papers (allusion aux fameux Pentagon Papers de 1971 révélant les mensonges sur la guerre du Vietnam et popularisés par un film de Spielberg). Récemment, le Washington Post a obtenu au nom du Freedom of information act ces milliers de pages de témoignages (environ 600), collectés par une agence dont l’acronyme SIGAR signifie : Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction.
C’est brutal et facile à résumer : nous avons dépensé presque mille milliards de dollars depuis 2001 ; près de 2400 de nos soldats y sont morts (sans parler des Afghans) ; c’est la guerre la plus longue et la plus coûteuse de notre histoire ; nous n’avons pas reconstruit l’Afghanistan ; nous avons menti ; nous n’avons jamais su quel en était le but ; nous ne savions même pas qui étaient les méchants (cette dernière expression est de D. Rumsfeldt lui-même). Sous trois administrations successives, nous n’avons gagné ni la guerre classique ni la guerre pour les cœurs et les esprits
Bref : à quoi sert la puissance ?
Guerre avec la vérité
En épargnant au lecteur toute pleurnicherie morale ou tout anti-impérialiste facile, ceci rappelle quelques évidences cyniques.
La machine d’État a de plus en plus de mal à conserver ses secrets. De D. Ellsberg le lanceur d’alerte de 1971 à E. Snowden en passant par Manning et Assange il se trouve toujours quelqu’un qui a accès aux archives compromettantes, trouve les moyens techniques de les exfiltrer et décide de les faire connaître au public, par scrupule moral ou autre. Ou il y aura une enquête et tout se saura. Plus une bureaucratie mobilise de cerveaux (humains ou numériques) pour archiver des données et répandre une version officielle de la réalité, plus vite elle est démentie. Le vieil adage qui veut qu’un secret à trois ne soit plus un secret vaut a fortiori cette échelle. Ici environ 400 personnes ont parlé et le puzzle se reconstitue très bien.
Une guerre demande trois conditions : savoir qui est l’ennemi, définir à quelles conditions on aura remporté la victoire et convaincre l’adversaire qu’il a perdu (faire céder sa volonté politique, en termes clausewitziens). Il est visible que les trois ont fait défaut. Comme le dit un des généraux interrogés « Il nous manquait une connaissance de base de l’Afghanistan, nous ne savions pas ce que nous faisions…. Nous ignorions ce que nous avions entrepris. Autrement, nous n’aurions pas accepté les versions utopiques de nos énoncés d’objectifs ». L’armée la plus puissante du monde n’a pas su résoudre le problème des interventions occidentales : se retirer après avoir écrasé l’adversaire principal désigné (ici d’abord al-Qaïda, puis les talibans avec qui on finira par négocier. Ou comment faire pour ne pas avoir plus d’ennemis le lendemain que l’on n’en a tué dans la journée ? Qu’il s’agisse de chasser ben Laden pour éviter un nouveau onze septembre, d’éliminer tous les jihadistes, de « construire une nation » avec une armée et un État, voire une économie prospère autre que celle de l’opium, de répandre nos valeurs ou notre démocratie, l’inflation des objectifs les rendait par définition impossibles. Tout aussi confuse fut la désignation des bons et de méchants, les trois administrations successives étant visiblement incapables de s’y retrouver dans les factions, ethnies, groupes armés, différences religieuses, hiérarchies et solidarités de ce pays.
Les deux points qui précèdent semblent peut-être évidents au lecteur. Le troisième est plus troublant. Puisqu’il y a des gens intelligents et honnêtes dans l’armée américaine et que la conscience de la catastrophe dans laquelle elle s’engageait existait sans doute sur le terrain, pourquoi l’évidence n’est-elle pas remontée ? Comment fut-elle dissimulée ? La question n’est pas neuve. Hannah Arendt la posait déjà à propos du Vietnam, et des « Papiers du Pentagone » (dans Du mensonge à la violence) : pourquoi mentir sur son inéluctable défaite ? Sans doute parce que l’objectif n’était vraiment ni la puissance, ni le profit, mais la production d’une image. Et parce que la machine d’État lancée ne rétrograde pas ?
Ce que le Washington Post appelle cruellement une guerre avec la vérité et qui dure depuis dix-huit ans, démontre à nouveau comment une bureaucratie a sélectionné l’illusion contre la réalité, se laisser bercer par des rapports qui racontent que, plus on se fixe des objectifs impossibles, plus on va de succès en succès et censure tous les signaux d’alertes. Des stratégies aussi apparemment contradictoires que celle de G.W. Bush (frapper les terroristes et maintenir une présence)et celle d’Obama (une contre insurrection massive et la reconstruction du pays) ont conduit a faire toujours plus du même en une commune incapacité à comprendre.
Une machine formatée pour mener une guerre de l’information (au double sens de tout savoir par la technologie et de propager son soft power) peut donc ignorer le principe de réalité non pas malgré mais à mesure de sa puissance même.
Une guerre, quel investissement, en vies et en argent ? Pour quel résultat ? Et quand sait-on qu’elle est perdue ? C’est la question que soulève un rapport de 2.000 pages, déjà baptisé Afghanistan Papers (allusion aux fameux Pentagon Papers de 1971 révélant les mensonges sur la guerre du Vietnam et popularisés par un film de Spielberg). Récemment, le Washington Post a obtenu au nom du Freedom of information act ces milliers de pages de témoignages (environ 600), collectés par une agence dont l’acronyme SIGAR signifie : Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction.
C’est brutal et facile à résumer : nous avons dépensé presque mille milliards de dollars depuis 2001 ; près de 2400 de nos soldats y sont morts (sans parler des Afghans) ; c’est la guerre la plus longue et la plus coûteuse de notre histoire ; nous n’avons pas reconstruit l’Afghanistan ; nous avons menti ; nous n’avons jamais su quel en était le but ; nous ne savions même pas qui étaient les méchants (cette dernière expression est de D. Rumsfeldt lui-même). Sous trois administrations successives, nous n’avons gagné ni la guerre classique ni la guerre pour les cœurs et les esprits
Bref : à quoi sert la puissance ?
Guerre avec la vérité
En épargnant au lecteur toute pleurnicherie morale ou tout anti-impérialiste facile, ceci rappelle quelques évidences cyniques.
La machine d’État a de plus en plus de mal à conserver ses secrets. De D. Ellsberg le lanceur d’alerte de 1971 à E. Snowden en passant par Manning et Assange il se trouve toujours quelqu’un qui a accès aux archives compromettantes, trouve les moyens techniques de les exfiltrer et décide de les faire connaître au public, par scrupule moral ou autre. Ou il y aura une enquête et tout se saura. Plus une bureaucratie mobilise de cerveaux (humains ou numériques) pour archiver des données et répandre une version officielle de la réalité, plus vite elle est démentie. Le vieil adage qui veut qu’un secret à trois ne soit plus un secret vaut a fortiori cette échelle. Ici environ 400 personnes ont parlé et le puzzle se reconstitue très bien.
Une guerre demande trois conditions : savoir qui est l’ennemi, définir à quelles conditions on aura remporté la victoire et convaincre l’adversaire qu’il a perdu (faire céder sa volonté politique, en termes clausewitziens). Il est visible que les trois ont fait défaut. Comme le dit un des généraux interrogés « Il nous manquait une connaissance de base de l’Afghanistan, nous ne savions pas ce que nous faisions…. Nous ignorions ce que nous avions entrepris. Autrement, nous n’aurions pas accepté les versions utopiques de nos énoncés d’objectifs ». L’armée la plus puissante du monde n’a pas su résoudre le problème des interventions occidentales : se retirer après avoir écrasé l’adversaire principal désigné (ici d’abord al-Qaïda, puis les talibans avec qui on finira par négocier. Ou comment faire pour ne pas avoir plus d’ennemis le lendemain que l’on n’en a tué dans la journée ? Qu’il s’agisse de chasser ben Laden pour éviter un nouveau onze septembre, d’éliminer tous les jihadistes, de « construire une nation » avec une armée et un État, voire une économie prospère autre que celle de l’opium, de répandre nos valeurs ou notre démocratie, l’inflation des objectifs les rendait par définition impossibles. Tout aussi confuse fut la désignation des bons et de méchants, les trois administrations successives étant visiblement incapables de s’y retrouver dans les factions, ethnies, groupes armés, différences religieuses, hiérarchies et solidarités de ce pays.
Les deux points qui précèdent semblent peut-être évidents au lecteur. Le troisième est plus troublant. Puisqu’il y a des gens intelligents et honnêtes dans l’armée américaine et que la conscience de la catastrophe dans laquelle elle s’engageait existait sans doute sur le terrain, pourquoi l’évidence n’est-elle pas remontée ? Comment fut-elle dissimulée ? La question n’est pas neuve. Hannah Arendt la posait déjà à propos du Vietnam, et des « Papiers du Pentagone » (dans Du mensonge à la violence) : pourquoi mentir sur son inéluctable défaite ? Sans doute parce que l’objectif n’était vraiment ni la puissance, ni le profit, mais la production d’une image. Et parce que la machine d’État lancée ne rétrograde pas ?
Ce que le Washington Post appelle cruellement une guerre avec la vérité et qui dure depuis dix-huit ans, démontre à nouveau comment une bureaucratie a sélectionné l’illusion contre la réalité, se laisser bercer par des rapports qui racontent que, plus on se fixe des objectifs impossibles, plus on va de succès en succès et censure tous les signaux d’alertes. Des stratégies aussi apparemment contradictoires que celle de G.W. Bush (frapper les terroristes et maintenir une présence)et celle d’Obama (une contre insurrection massive et la reconstruction du pays) ont conduit a faire toujours plus du même en une commune incapacité à comprendre.
Une machine formatée pour mener une guerre de l’information (au double sens de tout savoir par la technologie et de propager son soft power) peut donc ignorer le principe de réalité non pas malgré mais à mesure de sa puissance même.
Nous avons un quart de siècle de recul à la fois pour mesurer l’efficacité d’une intention et juger de sa cohérence. Ce qui pourrait se formuler ainsi : comment a-t-on « scientifiquement » défini la valeur universelle pour en faire une catégorie juridique ? Plus malicieusement : comment des représentants d’États ont-ils parlé au nom de l’humanité ou des générations futures et oublié leurs intérêts nationaux ou leurs revendications identitaires ? Plus médiologiquement : comment une organisation matérialisée (le Comité qui établit la liste, des ONG, des experts qui le conseillent…) a-t-elle transformé une croyance générale en fait pratique ? Comment est-on passé de l’hyperbole au règlement ? De l’idéal à la subvention ?
La désinformation repose sur la fabrication d’un faux message puis sa diffusion de façon qui semble neutre et dans un but stratégique. Il s’agit toujours d’agir négativement sur l’opinion publique pour affaiblir un camp. Ce camp peut être un pays, les tenants d’une idéologie, un groupe ou une entreprise...(on imagine mal une désinformation qui ferait l’éloge de ceux qu’elle vise).
En venant briser la réputation et l’autorité d’un candidat, en venant saper les fondements du discours officiel et légitime d’un État, les fake news et autres logiques de désinformation, viennent mettre au jour l’idée d’un espace public souverain potentiellement sous influence d’acteurs exogènes.
Nos sociétés de l'information exaltent volontiers la transparence. En politique, elle doit favoriser la gouvernance : plus d'ententes clandestines, de manoeuvres antidémocratiques obscures, d'intérêts occultes, de crimes enfouis. En économie, on voit en elle une garantie contre les défauts cachés, les erreurs et les tricheries, donc un facteur de sécurité et de progrès. Et, moralement, la transparence semble garantir la confiance entre ceux qui n'ont rien à se reprocher. Dans ces conditions, il est difficile de plaider pour le secret. Ou au moins pour sa persistance, voire sa croissance. Et pourtant...