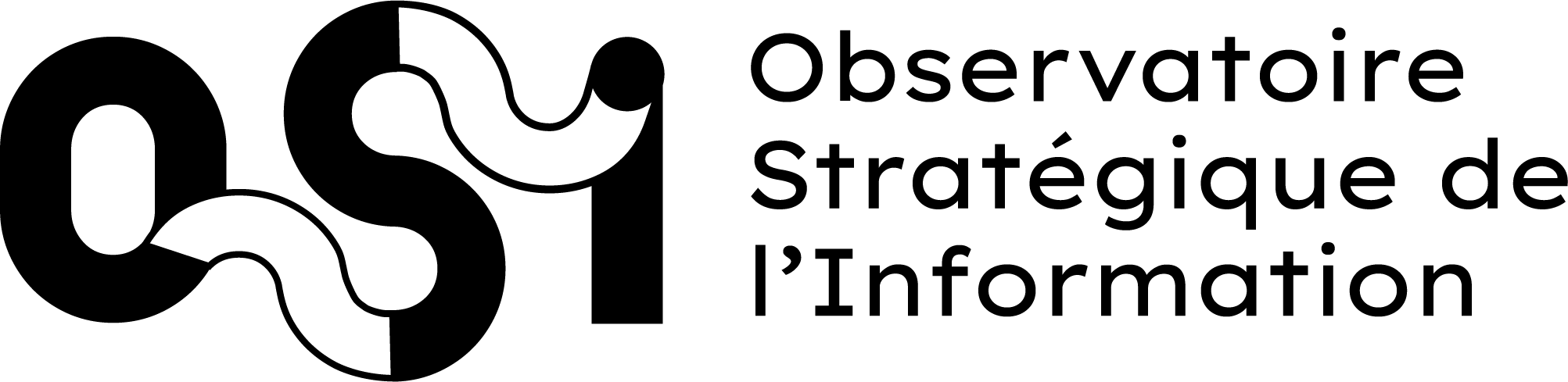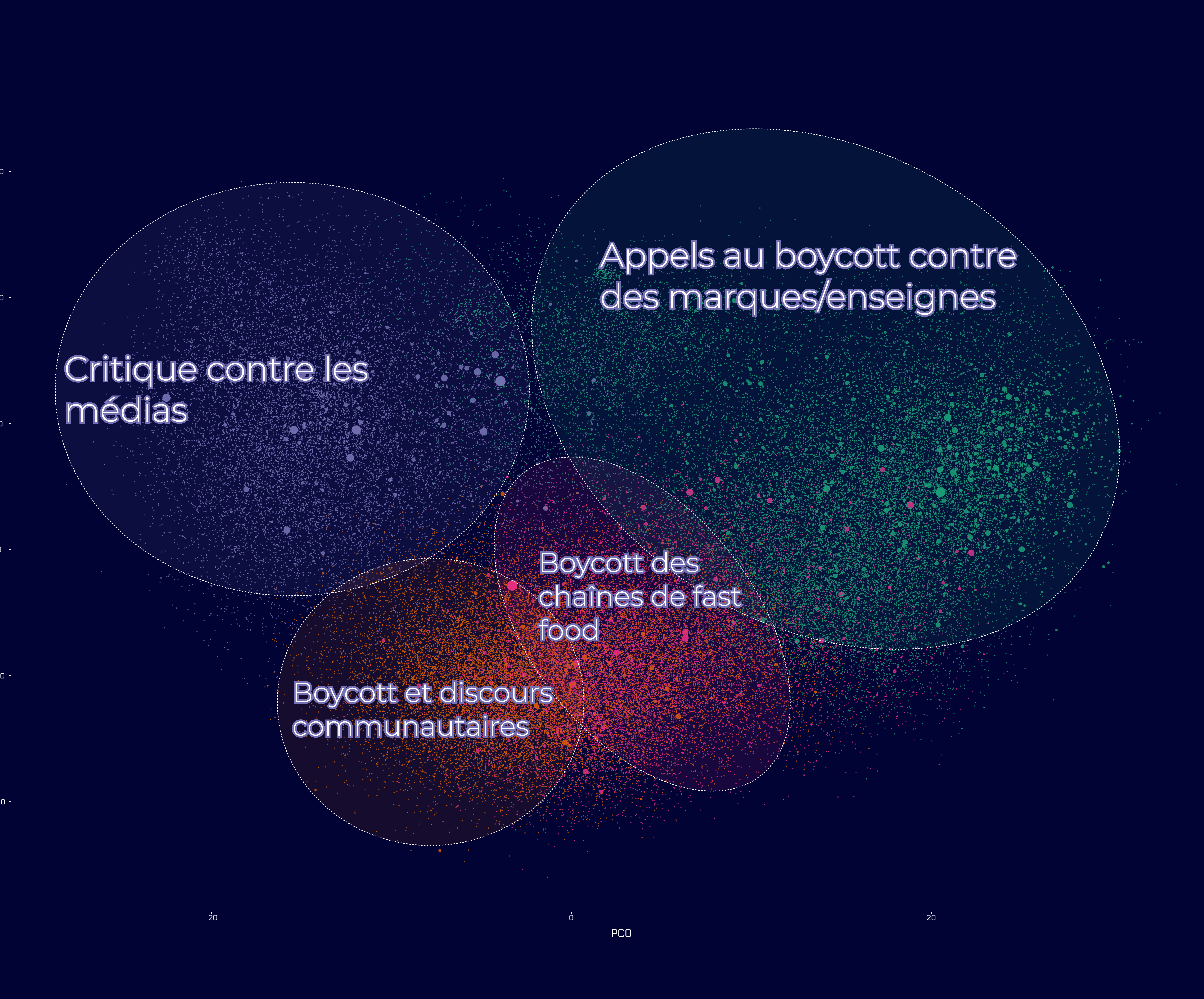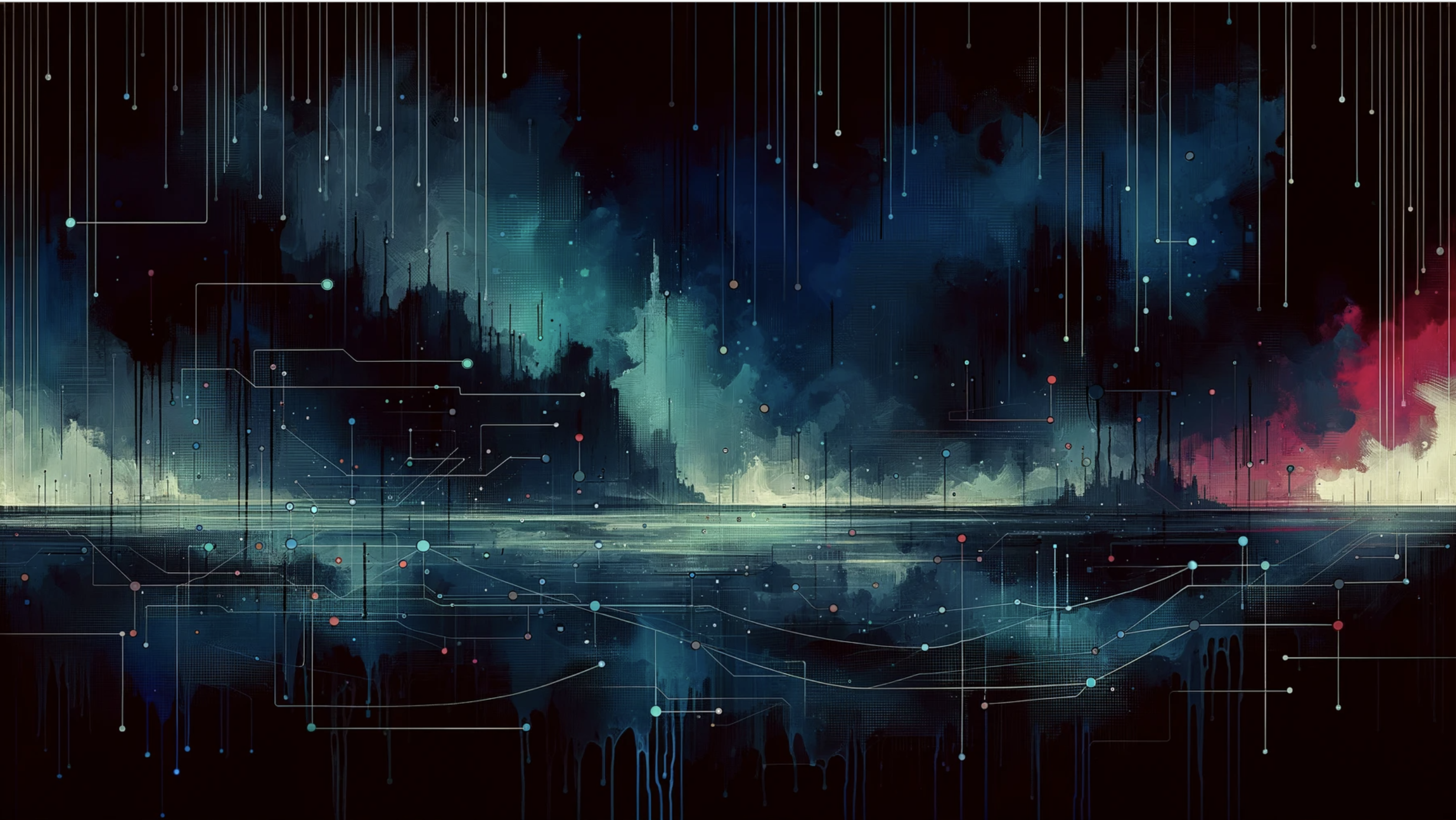Gilets jaunes, violences intercommunautaires, conflits identitaires… Guerre civile impossible, paix improbable
Auteur(s)
Date
Partager
Résumé
Pour notre part, nous ne doutons pas de voir des manifestations dures et des tensions exaspérées. Ni que les questions régaliennes reviennent au premier plan. Mais la conjonction de revendications et désordres fait-elle une guerre civile ?
Auteur(s)
Date
Partager
Résumé
Pour notre part, nous ne doutons pas de voir des manifestations dures et des tensions exaspérées. Ni que les questions régaliennes reviennent au premier plan. Mais la conjonction de revendications et désordres fait-elle une guerre civile ?
Guerre au terrorisme (Hollande), guerre au virus (Macron), guerre raciale après la guerre des classes (Valls), maintenant guerre civile ? Le thème a du succès après le raid dijonnais « des » Tchétchènes (seule communauté qu’il est médiatiquement licite de dénoncer par son nom pour l’opposer à «certains habitants de certains quartiers »), et il y a d’autres incidents armés à Nîmes ou ailleurs. Tout cela nourrit un discours alarmiste : violences en période de gilets jaunes, puis manifestations tendues pour les retraites, violences intercommunautaires, exaspération des conflits identitaires, crescendo, émeutes à l’allemande, guerre civile demain ? Pour notre part, nous ne doutons pas de voir des manifestations dures et des tensions exaspérées. Ni que les questions régaliennes reviennent au premier plan. Mais la conjonction de revendications et désordres fait-elle une guerre civile ? Montherlant la fait parler ainsi : « Je suis la Guerre civile, je suis la bonne guerre, celle où l’on sait pourquoi l’on tue et qui l’on tue : le loup dévore l’agneau, mais il ne le hait pas ; tandis que le loup hait le loup. « . Cela suppose au moins deux loups haineux. Comprenez : deux groupes qui se déclarent ennemis, deux parties qui obligent chacun à prendre parti, souvent contre le voisin ou l’ami d’hier. Donc un minimum de symétrie.
Un unique enjeu : l’ordre de la cité
La guerre (violence armée, durable, collective, visant à un état stable, la paix, mais celle du vainqueur) est, traditionnellement, affaire d’État. Dans les guerres civiles, les partisans, groupes privés, séparatistes ou révolutionnaires imitent la vraie guerre pour imposer leur idéal ou contrer un péril urgent.
Elle remet en cause le souverain déclenchant un processus chaotique d’exception. Les acteurs veulent s’emparer de l’État ou créer le leur ; en tout cas arracher à l’institution son monopole de la violence armée et fonder leur droit de tuer l’adversaire idéologique. Dans la tradition philosophique grecque stasis, la guerre civile est le pire des malheurs, alors que polemos, la guerre entre cités fait partie du cours ordinaire de la vie. Là où le terrorisme (les Grecs n’avaient, eux, que le tyrannicide) agit individuellement, la guérilla et la guerre civile mobilisent tous contre tous pour un unique enjeu, l’ordre de la Cité, le souverain principe.
Est-ce cela que nous vivons ? Nos haines – de classe, de race, de foi, choisissez- ne tuent encore guère (même si un retour des actions jihadistes est possible). La violence symbolique, elle, s’invente chaque jour : iconoclasme, humiliations et génuflexions, incrimination de l’autre réduit à son passé, remise en cause de tout ce qui est censé réunir les citoyens, criminalisation de l’autorité… Mais cela reste sporadique (voire hebdomadaire), théâtral ou plutôt audiovisuel, tant les désordres semblent imiter une série américaine avec ses répliques, ses stéréotypes ou ses émeutes. Les protestations servent plus à produire des images partagées qu’à prendre des palais présidentiels (Madame Traoré, stratège conséquente, nous dit que c’est ce que l’on ferait en Afrique).
Personne ne rend les armes
Un récent sondage révèle que nous sommes 47% à croire au racisme anti-blanc et 30% au racisme d’État. En bonne logique, cela implique 1) la moitié d’entre nous s’attend à être humiliée, demain dominée et 2) un tiers estime que toutes les proclamations antiracistes laïques, égalitaires, dans toutes constitutions et écoles depuis 1945, sont le masque idéologique d’une d’oppression barbare. Mais personne ne prend les armes.
La guerre civile suppose : mourir et tuer ensemble (la mort légitime sur la barricade ou collé au mur), s’armer ensemble (et pas seulement de pancartes ou de concepts), se regrouper (d’un côté où de l’autre d’une ligne de front), espérer ensemble (un ordre idéal), communier dans ses symboles (partager du passé et de l’avenir). Pas seulement détester ou dénoncer. Ni éprouver une même peur du chaos.
Trêve quasi féodale
Les communards ne voulaient pas seulement abattre des monuments ou changer des noms de rue, ils combattaient un envahisseur, un pouvoir tout frais élu et une armée, pas des coupables ou des préjugés. Ils n’attendaient pas d’excuses ou de compensations mais la victoire. Sans compter qu’ils risquaient le peloton, pas le plateau de BFM.
Après les incidents de Dijon (considérés par le président Kadyrov, comme des « actes corrects », provoqués par la seule mollesse des forces de l’ordre pour protéger ses compatriotes), Tchéthènes et Maghrébins auraient conclu un accord à la mosquée, avec trois moutons pour le pretium doloris. Cette trêve quasi féodale, après une guerre quasi tribale, ne donne pas une excellente image de l’autorité de l’État moderne. Territoire et hordes, rivalités de prestige et solidarité du sang, rituels et serments. Ces codes ne sont pas nouveaux. Quand la paix aussi se privatise, personne ne vise vraiment le pouvoir – sauf pour avoir liberté de trafiquer et de montrer ses biceps -. Ce n’est pas forcément une bonne nouvelle qu’il n’y ait plus de pouvoir à conquérir.
Guerre au terrorisme (Hollande), guerre au virus (Macron), guerre raciale après la guerre des classes (Valls), maintenant guerre civile ? Le thème a du succès après le raid dijonnais « des » Tchétchènes (seule communauté qu’il est médiatiquement licite de dénoncer par son nom pour l’opposer à «certains habitants de certains quartiers »), et il y a d’autres incidents armés à Nîmes ou ailleurs. Tout cela nourrit un discours alarmiste : violences en période de gilets jaunes, puis manifestations tendues pour les retraites, violences intercommunautaires, exaspération des conflits identitaires, crescendo, émeutes à l’allemande, guerre civile demain ? Pour notre part, nous ne doutons pas de voir des manifestations dures et des tensions exaspérées. Ni que les questions régaliennes reviennent au premier plan. Mais la conjonction de revendications et désordres fait-elle une guerre civile ? Montherlant la fait parler ainsi : « Je suis la Guerre civile, je suis la bonne guerre, celle où l’on sait pourquoi l’on tue et qui l’on tue : le loup dévore l’agneau, mais il ne le hait pas ; tandis que le loup hait le loup. « . Cela suppose au moins deux loups haineux. Comprenez : deux groupes qui se déclarent ennemis, deux parties qui obligent chacun à prendre parti, souvent contre le voisin ou l’ami d’hier. Donc un minimum de symétrie.
Un unique enjeu : l’ordre de la cité
La guerre (violence armée, durable, collective, visant à un état stable, la paix, mais celle du vainqueur) est, traditionnellement, affaire d’État. Dans les guerres civiles, les partisans, groupes privés, séparatistes ou révolutionnaires imitent la vraie guerre pour imposer leur idéal ou contrer un péril urgent.
Elle remet en cause le souverain déclenchant un processus chaotique d’exception. Les acteurs veulent s’emparer de l’État ou créer le leur ; en tout cas arracher à l’institution son monopole de la violence armée et fonder leur droit de tuer l’adversaire idéologique. Dans la tradition philosophique grecque stasis, la guerre civile est le pire des malheurs, alors que polemos, la guerre entre cités fait partie du cours ordinaire de la vie. Là où le terrorisme (les Grecs n’avaient, eux, que le tyrannicide) agit individuellement, la guérilla et la guerre civile mobilisent tous contre tous pour un unique enjeu, l’ordre de la Cité, le souverain principe.
Est-ce cela que nous vivons ? Nos haines – de classe, de race, de foi, choisissez- ne tuent encore guère (même si un retour des actions jihadistes est possible). La violence symbolique, elle, s’invente chaque jour : iconoclasme, humiliations et génuflexions, incrimination de l’autre réduit à son passé, remise en cause de tout ce qui est censé réunir les citoyens, criminalisation de l’autorité… Mais cela reste sporadique (voire hebdomadaire), théâtral ou plutôt audiovisuel, tant les désordres semblent imiter une série américaine avec ses répliques, ses stéréotypes ou ses émeutes. Les protestations servent plus à produire des images partagées qu’à prendre des palais présidentiels (Madame Traoré, stratège conséquente, nous dit que c’est ce que l’on ferait en Afrique).
Personne ne rend les armes
Un récent sondage révèle que nous sommes 47% à croire au racisme anti-blanc et 30% au racisme d’État. En bonne logique, cela implique 1) la moitié d’entre nous s’attend à être humiliée, demain dominée et 2) un tiers estime que toutes les proclamations antiracistes laïques, égalitaires, dans toutes constitutions et écoles depuis 1945, sont le masque idéologique d’une d’oppression barbare. Mais personne ne prend les armes.
La guerre civile suppose : mourir et tuer ensemble (la mort légitime sur la barricade ou collé au mur), s’armer ensemble (et pas seulement de pancartes ou de concepts), se regrouper (d’un côté où de l’autre d’une ligne de front), espérer ensemble (un ordre idéal), communier dans ses symboles (partager du passé et de l’avenir). Pas seulement détester ou dénoncer. Ni éprouver une même peur du chaos.
Trêve quasi féodale
Les communards ne voulaient pas seulement abattre des monuments ou changer des noms de rue, ils combattaient un envahisseur, un pouvoir tout frais élu et une armée, pas des coupables ou des préjugés. Ils n’attendaient pas d’excuses ou de compensations mais la victoire. Sans compter qu’ils risquaient le peloton, pas le plateau de BFM.
Après les incidents de Dijon (considérés par le président Kadyrov, comme des « actes corrects », provoqués par la seule mollesse des forces de l’ordre pour protéger ses compatriotes), Tchéthènes et Maghrébins auraient conclu un accord à la mosquée, avec trois moutons pour le pretium doloris. Cette trêve quasi féodale, après une guerre quasi tribale, ne donne pas une excellente image de l’autorité de l’État moderne. Territoire et hordes, rivalités de prestige et solidarité du sang, rituels et serments. Ces codes ne sont pas nouveaux. Quand la paix aussi se privatise, personne ne vise vraiment le pouvoir – sauf pour avoir liberté de trafiquer et de montrer ses biceps -. Ce n’est pas forcément une bonne nouvelle qu’il n’y ait plus de pouvoir à conquérir.
Quand ceux qui n’ont plus rien partagent le symbole du grotesque et de la vengeance, leur défi nihiliste nous annonce un singulier retour du conflit.
Le chiffre global tétanise : 33.769 attentats «islamistes» (se réclamant d’un projet d’établissement de la charia et/ou du califat) ont couté la vie à au moins 167.096 personnes.
Les black blocs, groupe affinitaire et temporaire, excellent dans la programmation numérique de l’action physique. Nihilisme symbolique et individualisme surexcité, le tout sur fond de communautés numériques : c’est bien la troisième génération de la révolte dont parle Régis Debray : sans contre-projet, mais dans l’action comme révélation de soi.
Quand l’Iran se coupe de la Toile pour isoler ses activistes, il révèle une fracture bien plus profonde.